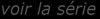Jusqu’au milieu des années 80 la Thaïlande intégrait ces nouveaux arrivants à ses populations locales puis, devant l’afflux de plus en plus important de réfugiés, les place dans l’un des 9 camps répartis le long de la frontière birmano-thaïlandaise. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés de l’ONU (UNHCR), avec une population de près de 50 000 personnes, le camp de Mae La est le plus grand, le plus peuplé et le plus ancien de ces camps. La majorité des réfugiés qui s’y trouvent sont Karen et chrétiens.
Selon les conventions internationales, un camp de réfugiés est sensé être provisoire, toute installation en dur y est donc proscrite. Les réfugiés n’ont ni le droit de quitter le camp sans autorisation spéciale, ni officiellement le droit d’y travailler. Leur seul espoir : le “re-settlement”, obtenir un permis d’immigration pour l’un des quelques états qui les accueille au compte goutte : les Etats-Unis, le Canada, l’Australie...
Alors on attend. D’être rejoint par un membre de sa famille toujours en Birmanie. De rejoindre l’un de ses proches, femme, enfant, parent, ayant bénéficié du re-settlement. On attend la distribution quotidienne de denrées alimentaires. Ou son conjoint parti travaillé illégalement en Thaïlande, dans l’espoir qu’il ne sera pas pris par les autorités thai. Ce qui serait synonyme de retour à la case départ, en Birmanie, avec les conséquences que l’on imagine.
On attend sans quitter ce camp provisoire. Un camp provisoire qui a plus de 20 ans...